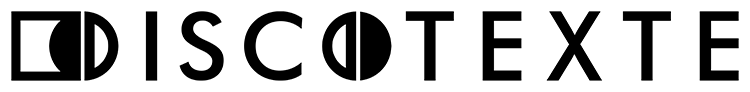Jusqu'au bout
de la nuit
![]()
ALB
« Come Out !
It’s Beautiful »
Après la collection de Mange-disque, le génie bricoleur Daquin a dispersé son groupe, remis le doigt dans l’engrenage de la composition et la main sur un nouvel accompagnant musicien. Travaillant sans relâche tout un âge de raison à sa machinerie consciente, ALB, Clément a sorti Come Out ! It’s Beautiful, un disque solaire dont il nous révèle l’orfèvrerie et l’ascension.
Avant de s’éclipser sous les projecteurs jusqu’au bout de la nuit.



Discotexte : Voilà bientôt un an que vous assurez la promotion de votre deuxième album, Come Out ! It’s Beautiful (Arista / Sony Music, 2014). Sans peine ?
Clément Daquin : Non, ça va. On défendait même l’album avant sa sortie, donc ça fait beaucoup plus de temps que ça finalement ! Mais on ne va pas se plaindre de faire plein de concerts, de la promo, et de préparer toujours d’autres choses autour de cet album. Mais, du coup, je manque de temps pour faire des nouvelles chansons. Et là, en ce moment, c’est la seule chose que je regrette un peu : de ne pas pouvoir faire évoluer le set et d’avoir déjà envie de le changer un peu, de rajouter certains morceaux.
Raphaël Jeanne : Ce n’est pourtant clairement pas le même set qu’il y a un an et demi.
Clément Daquin : Non, le spectacle en lui-même a évolué – avec des écrans lumineux derrière, et maintenant la batterie qui s’allume… Plein de choses sont en perpétuel mouvement. Mais le répertoire n’a pas changé, les chansons sont toujours les mêmes bien qu’elles soient « déformées ». Et ça, c’est un regret. Mais on continuera de défendre cet album : les gens le découvrent encore.
Et que reste-t-il de votre premier album, Mange-disque (Rise Recordings / Discograph, 2007) ? Certains de ses titres ne pouvaient-ils pas s’intégrer à votre set ?
Clément Daquin : Il n’en reste rien du tout. Si, un embryon : on fait 30 secondes de Sweet Sensation au début d’un autre morceau, comme un petit clin d’œil. Mais, non, il n’y a pas grand chose d’adaptable. Les chansons du premier album, elles sont mignonnes, mais je trouve qu’il y a une candeur que je n’ai pas forcément envie d’intégrer dans ce set. Et en plus, le majeur souci, c’est que ce n’est pas moi qui les interprétais – je chante sur deux, trois chansons, comme ça, très mal – mais un copain. Du coup, je n’ai pas envie de chanter les chansons qui ont été écrites, mises en place et en forme pour lui, en fait. On n’a pas le même registre : c’était une machine à chanter incroyable, que je poussais à faire des choses particulièrement lyriques… Mais bon, non, je ne me vois pas interpréter des chansons qui n’ont pas été écrites pour moi.
Raphaël Jeanne : Et comme tu l’as dit, elles ne sont pas particulièrement adaptables au set.
Clément Daquin : Voilà. Ça ne s’y prête pas. Dora Maar ? CV209 ? Qu’est-ce que…
Raphaël Jeanne : Non, ça ne fonctionnerait pas.
Clément Daquin : Non, c’est ça. Le projet reste le même : c’est le même esprit, le même univers. C’est une évolution.
Justement, les sept années qui séparent Mange-disque de Come Out ! It’s Beautiful, était-ce le temps nécessaire pour construire le deuxième album comme ne l’était pas le premier, et/ou se construire soi-même puisque vous vous êtes séparé des deux autres membres du groupe ?
Clément Daquin : Il y a un peu de tout ça. Et puis, ça se serait peut-être passé différemment si je n’avais eu que ça à faire dans ma vie, de préparer un nouvel album de ALB. Ce qui n’a pas du tout été le cas. ALB, c’est mon activité unique seulement depuis ces deux dernières années. Entre temps, ça a toujours été assez protéiforme, quand même, avec d’autres projets : certains pour bouffer, pas mal d’ateliers avec des jeunes, aussi, et puis une grosse tournée avec Yuksek qui a duré presque deux ans en comptant sa préparation. Et un enfant… Et tout au long de ces cinq années, effectivement, j’ai travaillé à ce projet, à sa remise en question. Mon bassiste s’était barré pour les Bewitched Hands, et son départ m’a un peu poussé à me dire que c’était le moment de remettre les choses à plat. Et à Aliou [Aliocha Lauwers, ndlr], je lui ai fais : « Bon, ok, ça marche pas bien en groupe, donc je vais continuer tout seul… Désolé. » Il n’était pas très content, mais ça s’est plutôt bien passé – enfin, je vais pas rentrer dans les détails… Du coup, j’ai continué tout seul avec une formule live, le prototype de la combinaison actuelle ; à savoir : quelques machines autour de moi, et déjà un système de pédales pour changer mes petites séquences, mes petites conneries, mes sons Nintendo – c’était une formule encore plus geek que celle d’aujourd’hui ! Et finalement, j’ai repris un batteur. Enfin, voilà, j’ai vraiment tout repris à zéro en live pour arriver à la formule qu’on connaît. Et puis, j’ai appris à chanter, appris à jouer du piano, appris… tout !
Et le résultat, s’il s’est fait attendre, se fait aussi entendre : Come Out ! It’s Beautiful est un album très abouti. Quel a été le processus de création ?
Clément Daquin : J’ai toujours travaillé dans mon petit studio, avec tous mes instruments. C’est un confort grâce auquel tu peux développer des morceaux et des arrangements autant que tu veux. Mais tu développes aussi le syndrome du « plus tu as de temps et plus tu prends du temps » : quasiment cinq années se sont écoulées pour réunir tous les morceaux qui sont sur l’album. Au départ, j’avais déjà un embryon de quatre, cinq titres, dans lequel j’ai décelé comme une sorte d’histoire, d’évolution possible, avec des morceaux plutôt pop et assez simples et d’autres très électroniques et un peu déstructurés. J’organisais mes petits bouts de papier avec les noms des morceaux dessus, et je me suis dit : « Tiens, il y a peut-être quelque chose d’intelligent à faire, en terme de démarche, dans l’évolution des titres, et de voir quelle peut être l’articulation ente eux, depuis Hypoballad – qui est forcément celui qui démarrera l’album – à Take Advice – qui est forcément celui qui le terminera. »
Vous êtes donc désormais derrière le micro et tous les instruments – sauf la batterie –, mais aussi derrière l’entière production : y a-t-il une volonté de tout contrôler ?
Clément Daquin : Oui. Je pense que ça fait partie du package global. Après, je ne sais pas si c’est un truc constant… « Ouais, de toute façon, je veux bosser comme ça, et je suis comme ça, et j’ai envie d’être tout seul ! » : ça, c’était en réaction avec la façon de travailler sur l’album d’avant, sans doute. Je ne réagis plus forcément de la même façon maintenant. Est-ce que c’est un vrai trait de caractère de me dire que j’ai envie d’absolument tout contrôler seul ? J’ai envie de contrôler le projet, oui. Mais je ne suis pas dans le « C’est moi qui fais tout ! Ah, c’est trop bien ! » Je suis content d’enregistrer des prises de batterie avec des batteurs talentueux, ou des cuivres parce que je n’ai jamais su jouer de trompette ou de cor de ma vie…



C’est très ambigu. Vous dites que tous ceux qui vous accompagnent dans cette aventure constituent le projet ALB, et en même temps, vous avouez en être son autocrate…
Clément Daquin : Il y a deux phases assez distinctes : les morceaux et puis le live. J’écris des chansons tout seul. Et à partir du moment où, ça y est, j’ai la structure du morceau, son ossature, et que je peux commencer à enregistrer ma ligne de basse – « tu-du-du » –, mes « la-la-la », « gling-gling-gling », « piou-piou-piou », mes synthés, tout jouer ensemble, et puis faire des arrangements, c’est mon plus gros kif, c’est vraiment ce que je préfère.
Raphaël Jeanne : Maintenant, tu as besoin, aussi, qu’il y ait d’autres gens, des regards extérieurs…
Clément Daquin : C’est clair. En fait, à Reims, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j’avais une petite équipe de gens, toujours les mêmes, qui passaient régulièrement au studio fumer une clope, boire un café, venir écouter, etc. Et de tous ces gens, je n’attendais pas forcément la même chose, mais chacun de leur avis comptait. Toujours. Il y avait le copain, très esthète : « Tiens, c’est marrant, ça me fait penser à… Tu devrais écouter ce morceau-là, surtout pour la prod’ de la rythmique » ; celui qui arrivait en disant : « Il y a un peu trop de 800 hertz sur la grosse caisse, mais sinon, ça sonne pas mal » ; l’autre qui ne faisait même pas la différence entre la guitare, la basse et la batterie, mais qui écoutait le morceau et se disait : « Oh, il est cool le nouveau morceau ! Ah ouais, "na-na-na-na-na", c’est bien, ça ! » Donc, oui, l’avis des autres compte à mort. Le vrai problème de mon système, c’est que je ne suis vraiment pas très sûr de moi non plus… Alors je passe mon temps à écouter les chansons que j’écris. Mais je veux quand même tout faire !
Cet absolutisme musical, cette volonté de perfection, vous l’obtenez aussi grâce à une âme de « bidouilleur ».
Clément Daquin : Je pense que je fais la musique qui me représente, d’une certaine manière : c’est un mélange de plusieurs choses, et, oui, j’aime bien bricoler un peu. Je pars du principe que les choses, je peux les faire tout seul, me débrouiller : ce n’est pas forcément un plaisir de foutre les mains dans la soudure, mais je suis capable d’ouvrir un machin avec un tournevis, et je vais bien réussir à lui percer un trou ou deux histoire d’y brancher une sortie audio. J’essaie toujours d’aller au bout de ce que je veux faire sans me poser trop de questions. Et si ça ne marche pas, tant pis. Tout part d’une idée, ou plutôt d’un besoin – parce qu’il faut trouver une solution à une problématique en live : ma pédale d’écho ne reçoit pas, et je suis obligé de taper à la main dessus, pourtant j’aimerais bien lui envoyer une synchro, mais comment faire ? On va sortir le fer à souder, et puis on va se débrouiller ! Ce sont les besoins qui nécessitent le bricolage. Et le manque de moyens, aussi. Beaucoup.
Raphaël Jeanne : Comme avec les décors…
Clément Daquin : On se disait : « On va avoir des gros écrans derrière, qui tapent, avec de la lumière, et tout… » Mais à notre niveau, des panneaux de LED, ce n’est pas imaginable : ça vaut une fortune, ça prend une place folle… Et voilà, on a fabriqué deux espèces de chambres remplies de barres de LED et de structures réfléchissantes à moindre coût, qui s’illuminent et que l’on pilote nous-mêmes avec nos machines : c’est fait à partir de 80 mètres de tubes en aluminium qu’on a coupés, avec des angles en plastique, et ma maman a filé le coup de main pour la couture de grandes toiles. Ça nous a coûté 1500 balles, ça tient dans deux flights, et on les sort dès qu’on est plus de quatre personnes, parce que ça demande un petit temps de montage et de démontage…
Le décor dont vous rêviez, c’est celui de votre prestation aux 30e Victoires de la musique ? Comment êtes-vous parvenus à présenter un projet visuel comme celui-là ?
Clément Daquin : « Allô, Clément ? T’es assis ? » « Ouais, je suis sur mon scooter ! » « T’es prêt à jouer aux Victoires ? » « Oh, putain ! Cool ! » « Alors, vas-y : tu nous fais un truc de ouf, hein ? T’as open-bar ! » « Ok ! Salut Vincent ! » – le patron du label [Vincent Boivin, directeur d’Arista chez Sony Music France, ndlr]. Cette année s’est déroulée comme une espèce d’enchaînement de choses un peu improbables, avec des festivals genre Rock en Seine, où je n’aurais jamais imaginé jouer, jusqu’à cette nomination, un peu surréaliste. J’ai eu envie de marquer le coup. Enfin ! Peut-être que c’est la seule fois de ma vie où on va jouer aux Victoires de la musique ! Et si ça doit être la seule fois de ma vie, autant que ça soit un truc qui défonce, que ce soit les Grammy Awards de la musique de France ! Cette cérémonie a la réputation d’être un peu ennuyeuse et longue. Alors, qu’est-ce qui va faire que les gens vont retenir cette performance plus que les autres, qu’on va réussir à se démarquer ? J’étais allé avec ma fille à la Gaîté Lyrique, et j’ai déliré avec l’installation Murmur [présentée lors de l’exposition « Capitaine futur et le voyage extraordinaire », ndlr] pendant un quart d’heure. Et puis c’est sorti complètement de ma tête. Et quand on a commencé à penser à la scénographie, on avait juste les informations de base : nous, on éclaire un peu nos instruments nous-mêmes, et on savait qu’il y aurait 400 m2 d’écrans derrière nous sur scène. On avait envie d’une interaction, avec des câbles lumineux – une idée qui traînait déjà avant, pour le live… Et là, ça a fait : « Putain ! Le truc de la Gaîté Lyrique ! Mais oui, c’est ça l’idée ! Faut qu’on bosse avec Chevalvert ! C’est génial, ça colle trop bien, c’est exactement ce qu’il faut entre les instruments et l’écran ! » On a taffé dessus, on a fait que ça pendant plus d’un mois. Tous. Julien, un de nos deux ingé’ son, a fait office de régisseur sur le projet – il était au centre de tous les trucs : les coups de fil, le piano Peugeot, son transport, le visu’, les lumières, la disposition, etc. Nous, on avait le côté créa’ : les commandes à Led’s Try et compagnie aux États-Unis pour faire équiper la batterie en LED. Et moi, pendant ce temps-là, je suis en train de négocier tous les budgets avec le label et le tourneur. Ça a été un casse-tête. Cette créa’, elle a coûté 30 000 balles, au total…

On comprend mieux la déception et la colère qui ont suivi votre prestation… Car deux millions de téléspectateurs ne l’ont probablement pas remarqué, mais je crois savoir que vous avez eu un petit problème technique…
Clément Daquin : (rejouant la scène) Fais chier, alors ! (à lui-même) « N’y pense pas. Ça va. Les gens n’ont rien vu. »
C’est un mauvais souvenir ?
Clément Daquin : Ouais, du coup. Nous, on avait absolument tout maîtrisé. Et ça, c’était complètement indépendant de notre volonté.
Raphaël Jeanne : C’est même quelque chose qu’on a justement cherché à anticiper !
Clément Daquin : Le plus frustrant, c’est quand les gens te disent après : « Non, mais, c’était hyper bien ! Peut-être que vous avez été un peu trop ambitieux, voilà ? » Non, hors de question ! C’était parfait. Notre truc marchait au poil. On n’a pas reçu le signal synchro’ au début de la chanson, ce n’est pas de notre faute. Heureusement, depuis, on s’est rattrapés – il y a même encore de la promo’ qui découle de ça…
Quel rapport entretenez-vous avec Whispers…, que vous avez choisi comme single de l’album et que vous avez donc présenté à ces « Victoires » ?
Clément Daquin : Et qu’on va encore se rebouffer la semaine prochaine pour les 10 ans de France 4 ! Je commence à en avoir un peu marre, là… C’est une chouette chanson, je l’aime vraiment bien. Je ne sais pas si je l’ai « choisie », je ne me suis jamais posé la question, en fait : pour moi, c’était évident. Je n’avais pas envie que ce soit Golden Chains parce qu’il avait déjà été pas mal usé [notamment pour la campagne publicitaire de la Peugeot 208, en 2012, ndlr], alors que ce morceau, je trouvais qu’il représentait bien l’album. Ce n’est pas tant son côté plus catchy qu’un autre – c’est encore un morceau chelou où il n’y a pas de refrain, seulement une espèce de couplet avec une fin sur une tonalité différente –, mais il arrive au milieu de l’album comme le bon mélange d’une chanson pop avec un truc un peu psyché-pompier qui annonce le style de certains titres, après, avec beaucoup d’arrangements.
Raphaël Jeanne : Et puis Whispers… a longtemps été en rotation radio. Dans l’inconscient collectif, c’est « le morceau de la radio »…
Clément Daquin : Même si d’autres, dans l’album, ont plus de vécu que lui. Le single est très vite devenu « le morceau de la pub télé » [pour la Peugeot 3008, ndlr], « le morceau de la radio », etc. Alors, je m’en suis très vite… non pas débarrassé mais désapproprié, en fait. Toute la première année, quand on le jouait en live, c’était vraiment flagrant : on avait vraiment l’impression de jouer « la chanson de la radio » ou un truc qui passe à la télé, mais plus un morceau à moi, ou de moi. C’était assez bizarre. Heureusement, ça me le fait moins maintenant. Il reste toujours le morceau le plus efficace pour identifier le projet, mais de là à le justifier encore comme single, à le mettre en avant, non. D’ailleurs, on sort The Road dans les prochaines semaines, avec un clip.
Justement, à l’instar de ce live des « Victoires », le concept et l’image se conjuguent aussi dans vos clips, toujours très originaux et récemment interactifs.
Clément Daquin : En fait, le majeur problème des clips, maintenant, c’est que tout le monde s’en fout. Alors qu’à la base, c’est quand même un support de communication.
« Le Mange-disque qui a été vendu dans le clip de Golden Chains, c’était mon dernier exemplaire. J’avais demandé aux mecs de le foutre aux enchères, et prévu de mettre – je ne sais pas, 500 balles ? – n’importe quel montant, pourvu que personne ne l’atteigne et que je garde mon disque, en fait. Sauf qu’ils l’ont mis en achat immédiat à 50€ – peut-être même moins. Et c’est le premier truc qui est parti. Direct. Obligé de vendre mon disque ! »
Dans les bars, sur MTV Pulse ou je ne sais quelle chaîne de clips, c’est en boucle : comme la radio avec des images qui bougent. Mais les gens ne regardent plus les clips, à part ceux dans la timeline de Facebook. Aujourd’hui, on voit tout à travers la lucarne de l’ordinateur, donc autant s’en servir et proposer des projets plus globaux et plus complets qu’une simple illustration de la musique. Je trouvais important que le clip raconte autre chose, qu’il ne soit plus le support de la musique, mais que la musique devienne elle-même le support de quelque chose. Ceci dit, le clip de The Road ne sera pas interactif, juste esthétique – et ça me perturbe un peu, mais bon, il y a un parti pris intéressant, alors, voyons voir…

Par le passé, vous avez travaillé dans un centre de musique contemporaine, en participant à des ateliers avec des jeunes en réinsertion. Transmettre, à travers ce genre d’enseignement, la scène et la musique de façon plus générale, cela vous importe ?
Clément Daquin : Oui, le partage, c’est important. C’était super, ces ateliers. C’était vraiment une expérience incroyable, très riche. Ce centre de musique contemporaine avait un partenariat avec l’école de la deuxième chance, où des jeunes à problèmes, qui, généralement, viennent de la DDASS ou ont déjà fait un séjour en prison, ont droit à des cours et une intégration via des performances artistiques. On avait quelques mois d’apprentissage derrière des ordinateurs avec Ableton Live, et en milieu d’année, quand ils avaient compris comment ça marchait, les effets, les boucles, etc., on préparait la pièce de fin d’année : nous, on enregistrait des choses en temps réel, on s’occupait de la musique pendant que d’autres apprenaient leur texte et faisaient un peu d’actor studio. Ça a vraiment fait partie de ma vie pendant deux ans, deux jours par semaine. C’était assez intéressant et intense.
Ce genre d’expérience nourrit-elle le projet ?
Clément Daquin : Humainement parlant, bien sûr… Tout nourri le projet, je pense.
La paternité également ?
Clément Daquin : Ouais, mais c’est compliqué. Ça va, hein, mais c’est dur… C’est le Bronx. C’est déjà un bordel pour tout le monde, alors là… Dès que je ne suis pas en concert, je suis avec ma fille. Elle est à un âge – 3 ans – auquel elle exprime son ressenti, donc ça commence les : « Papa, moi, j’aime pas quand t’es pas là ! » Le petit bout… « Moi non plus. Je t’aime. Tu me manques. » « Moi aussi tu me tu manques » – je ne sais plus comment elle me dit… Bref. Mais c’est super. Et c’est forcément une nourriture aussi pour le reste.
Et une frustration aussi pour l’artiste, qui ne trouve plus le temps de travailler… Avez-vous réussi à composer durant cette tournée ?
Clément Daquin : Non. Pas le temps. Rien. Enfin, si : trois, quatre bricoles… Et ça me manque carrément. Non, ce n’est pas tant ça : ça m’angoisse, surtout.
Auriez-vous des échéances à respecter vis-à-vis de votre maison de disque ?
Clément Daquin : C’est ça. Quand je leur dis : « Un album en février ? Non mais tu rêves ! », ils sont là : « Ah ! Mais quand même pas après le printemps ! » « Ouais, enfin, le printemps, c’est juste un mois après février ! C’est pareil ! Faut même pas y penser non plus ! » Je mets du temps, quand même, à faire les choses… Et puis je suis relou. Disons que je ne sortirai pas quelque chose dont je ne suis pas satisfait. Je ne sortirai pas un album avec douze titres au mois de mars seulement parce qu’il le faut… Donc, voilà, ça prendra le temps que ça prendra : si ça se trouve, ce sera dans cinq ans ! On n’en sait rien ! Moi, ça ne me dérange pas de disparaître, et puis de réapparaître plus tard… Entre Mange-disque et Come Out !…, il y a eu dix mille questionnements, dix mille évolutions, à la fois sur scène et dans ma musique – ne serait-ce que dans la manière de chanter mes chansons, tiens… Ok, maintenant, il y a plein de questions que je ne me pose plus. Et puis je pense vraiment que le projet est lancé. Mais bon…


ALB devrait donc garder le visage d’aujourd’hui sur le prochain album ? Et sur scène ?
Clément Daquin : Ce sera la même formule, oui. Après Mange-disque, j’avais construit une autre formule à quatre dont j’étais le centre et l’interprète des chansons, avec un clavier, un bassiste et un batteur. Mais ça ne me convenait pas, et je me suis rendu compte que ce qui m’importait réellement, c’était la batterie. Mon alter ego dans ALB et sur scène, c’est le « poum-tchac », et je n’ai finalement pas besoin d’autre chose. Je suis donc revenu à cette formule où j’étais tout seul avec mes petites machines, mes petites cartouches. Sauf qu’au lieu d’avoir des boîtes à rythmes, j’ai un batteur : finalement, c’est un mix’ de la formule groupe avec la formule solo. Cette formule-là existe aussi par souci économique : c’était important de tourner à quatre, c’est-à-dire d’avoir toujours avec moi mes ingénieurs du son – parce que j’attache énormément d’importance au son – et des lumières – parce que les lumières, c’est la moitié d’un spectacle quand tu es dans une salle. Avoir le confort de deux techniciens, c’est un luxe que peu de groupes peuvent se permettre parce qu’ils sont déjà trop nombreux sur scène. Du coup, ça nous permet de proposer un show et pas juste un concert. Quand Raphaël est arrivé, cette formule était déjà en place : « Vas-y, assieds-toi en face, mon ami ! »
Comment a débuté votre histoire commune ?
Raphaël Jeanne : À l’époque, j’avais d’autres projets sur lesquels je faisais plutôt de la basse et des claviers, à l’ordi’. Je ne m’en rappelle toujours pas, mais il y a eu ce fameux Cabaret Vert 2012 où Clem’ jouait avec Yuksek, et moi avec About the Girl. Il m’aurait vu taper sur scène. Il est venu me voir dans les loges : « Ah ouais, tu fais de la batterie ? Ça te dit de faire une entrevue, voir comment ça se passe ? » Sauf que moi, je connaissais déjà toutes ses chansons : j’étais un ultra de la première heure !
Clément Daquin : Il avait déjà des démos de l’album, qu’il avait récupérées je ne sais comment ! Donc, les titres que j’allais lui demander de jouer avec moi, il les connaissait déjà tous par cœur : les breaks, les structures – tout ! Il est arrivé au studio : « Elle est où la batterie ? » et « pou-ta, pou-ta », c’était parti. On a répété une après-midi, et c’était bon, c’était plié. Cool.
Raphaël Jeanne : Ouais, c’était cool. Et pour moi, c’était un honneur !
Clément Daquin : Alors que moi, je flippais ! Parce que mon quasi unique interlocuteur en musique, finalement, c’est le batteur ; parce que le seul instrument que je laisse à quelqu’un, c’est la batterie. J’avais déjà une relation privilégiée avec Thomas [Dupuis, ndlr], le « deuxième ALB qui ne compose pas », l’éponge à mes questionnements : donc c’était dur d’imaginer le remplacer. Vraiment. Je lui avais tellement rongé le cerveau pour que sa batterie sonne ALB, que ça soit comme ci, comme ça, que c’en était devenu parfait. Trouver quelqu’un d’autre, c’était tout remettre à plat. Et puis non. Raphaël frappe différemment, mais il joue sur la batterie ALB, qui sonne comme ça doit sonner dans mon projet : il a juste apporté une autre dynamique…
Raphaël Jeanne : Et des cymbales, aussi ! (rires)
Clément Daquin : Finalement, je flippais surtout qu’il doive réapprendre toutes ses parties, mais cette question ne s’est même pas posée deux heures !
La notoriété grandissante de ALB, vous la devez aussi aux médias, qui ont, encore aujourd’hui, beaucoup de mal à vous dissocier de Yuksek…
Clément Daquin : Ah ouais ? C’est juste qu’ils ont besoin de références, de raccrocher et de situer les gens entre eux : Yuksek, The Shoes, Brodinsky – la scène rémoise, et mes copains, quoi. Je m’en fous, honnêtement. Mais je n’aime pas qu’un journaliste, en face de moi, se mette à parler de ça parce qu’il n’a pas bossé le sujet et qu’il ne sait pas de quoi on va parler ; je n’aime pas que ça prenne le pas sur le projet. Après, c’est normal que ça ressorte puisque Pierre [Pierre-Alexandre Busson, connu sous le nom d’artiste Yuksek, ndlr] a été la personne la plus proche de moi ces dix dernières années : on a tourné pendant un an et demi avec Klanguage, notre premier groupe, on a travaillé sur d’autres projets communs dans le studio qu’on partage à Reims, on a aussi bossé sur sa deuxième tournée et on a fait deux fois le tour du monde ensemble…
Raphaël Jeanne : Cette scène, moi, c’est ce qui m’a fait rester à Reims – parce que je ne suis pas Rémois !
Clément Daquin : Moi non plus, en fait !
Raphaël Jeanne : Moi, je suis un petit Normand – je suis de Caen – qui a envie de faire de la musique depuis tout gamin. Et j’arrive là juste pour mes études, dans une ville où il y a une dynamique, plein de projets qui sortent, des trucs qui me filent des émotions et dans lesquels je me reconnais. Alors, forcément, j’ai eu envie de participer à ça. Et je suis resté sept ans de plus à Reims. Sinon, je serais peut-être reparti.
Clément Daquin : Moi, je suis arrivé à Reims il y a quinze ans, et je viens d’en repartir. Cette dynamique, c’est une bande de potes, de zicos, qui se connaissent depuis qu’ils sont minauds ou se sont connus par le biais de la musique. On s’est tous développés ensemble, chacun avec une direction différente, et tous ces projets sont nés en parallèle. Vraiment. Personne ne veut faire comme l’un ou comme l’autre, on ne se marche pas dessus : au contraire, tout le monde écoute la musique des uns, des autres, parce qu’on se connaît tous – on a tous plus ou moins joué ensemble, ne serait-ce que pour un concert ou un truc spécial…
Justement, que sont devenus vos anciens projets : Invaders, Klanguage ?
Clément Daquin : Oh la la ! Klanguage, en 2008, c’était mort. Ça a été le projet d’un album unique. On a fait une tournée et on a arrêté. C’était chouette, mais Pierre n’était pas fait pour faire de la pop – en tout cas, pas de cette manière-là – et Marianne [Marianne-Elise Simonot, chanteuse du groupe SAF, ndlr] a pris d’autres chemins aussi. Et moi j’étais déjà à donf sur ALB et Invaders, un projet avec Nicolas Karst, alors bassiste de ALB et des Bewitched Hands. J’imaginais ma musique comme une éponge, avec ALB, côté doux, et Invaders, côté qui gratte. C’était vraiment un projet complètement débile.
Raphaël Jeanne : Le défouloir…
Clément Daquin : Total. On y mettait toutes les influences de merde possibles et inimaginables – le tuning, la grosse dance dégueu’, les textes qui parlent que de cul – avec des tempos très élevés. C’était assez drôle. Même en live : on se demandait toujours ce qu’on allait pouvoir faire comme connerie sur la prochaine date : « Arriver en mobylette ? On l’a déjà fait… » C’était une espèce de musique électro avec un gros côté « toum-doudoudoum-doudoudoum-doudoudoum »…
Raphaël Jeanne : Hardcore-italo ! (rires)
Clément Daquin : Ouais, c’était un peu ça. Parce qu’il pouvait y avoir « toum-doudoudoum » et « pah-pah-pah » ! Hardcore-italo-8 bits, quoi ! Avec des paroles, parce que c’était surtout des chansons, et des harmonies, des chœurs, des « aaaah-ahhh-ah » et des « ni-ni-ni-ninini-niiii » même sur les deux, trois instrumentaux. C’était vraiment un gros mix. Electric Light Orchestra-Nintendo-hardcore…
Raphaël Jeanne : De l’ELO-gamer, quoi ! (rires)
Il y a eu cette autre scène, Versaillaise, qui a vu naître la French Touch et avec elle deux de vos pairs et aînés, Jean-Benoît Dunckel (Air) et Alex Gopher, qui figurent d’ailleurs sur l’EP Whispers…
Clément Daquin : Je trouvais ça marrant. Et c’est un peu un hasard. J’ai rencontré Gopher via Guillaume [Brière, ndlr], des Shoes. Son mix, il est super – il l’avait déjà fait depuis un moment, genre un an ou deux ! Depuis, je le croise souvent à Paris – comme toute cette clique-là, d’ailleurs, des ingénieurs du son, mastering et autres… Jean-Benoît, on a des connaissances communes dans le business de la musique, et, en plus, on a fait quelques dates avec son autre projet, Tomorrow’s World. Quand je lui ai proposé de faire un mix, il a accepté. Je suis très content. Je trouve que c’est assez cohérent de les avoir tous les deux, parce qu’ils ont marqué la musique, celle que j’ai beaucoup écoutée à une époque. Mes « pères » m’encouragent : « Vas-y, mon fils, on t’adoube ». Et pour couronner le tout, c’est « Alf » [Stéphane Briat, mixeur-réalisateur « attitré » de ladite French Touch, ndlr] qui a mixé mon album !

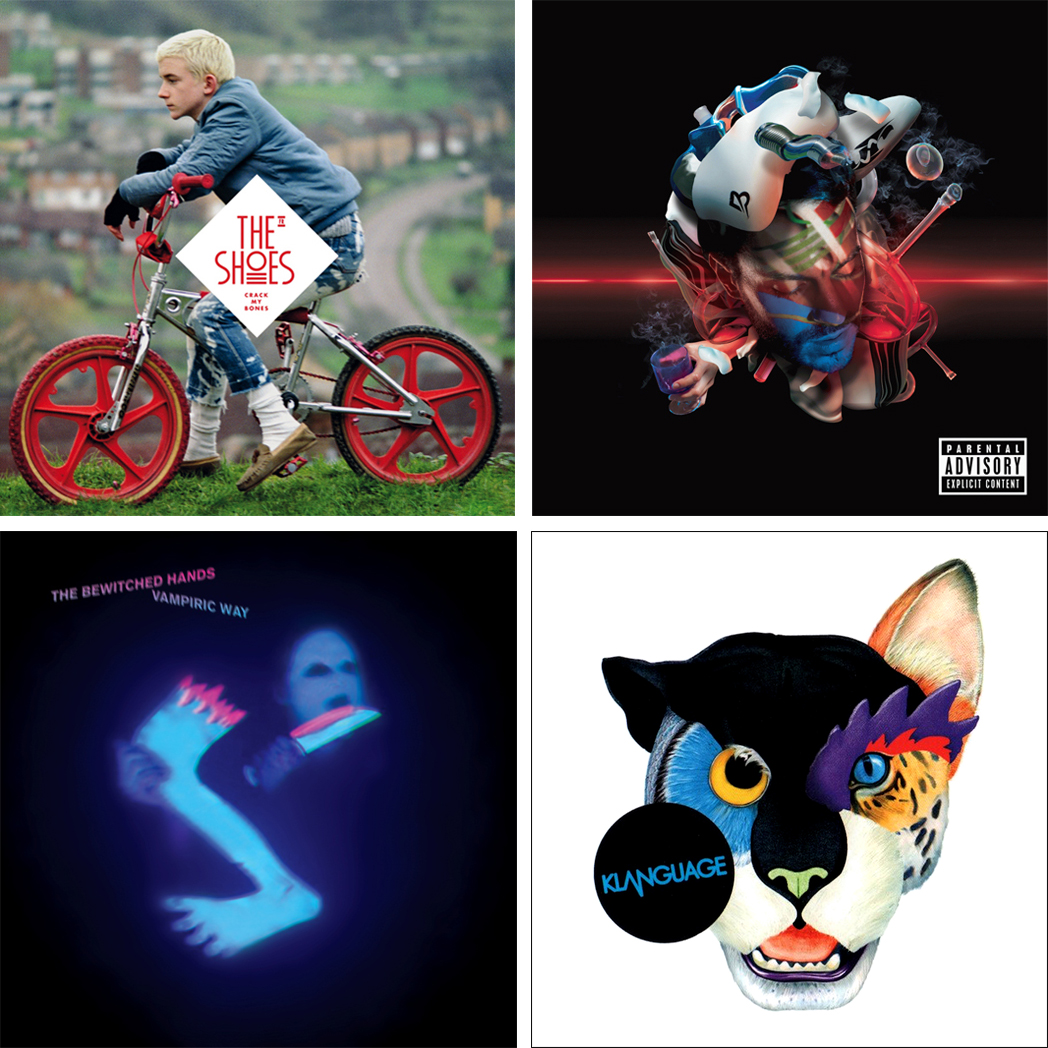
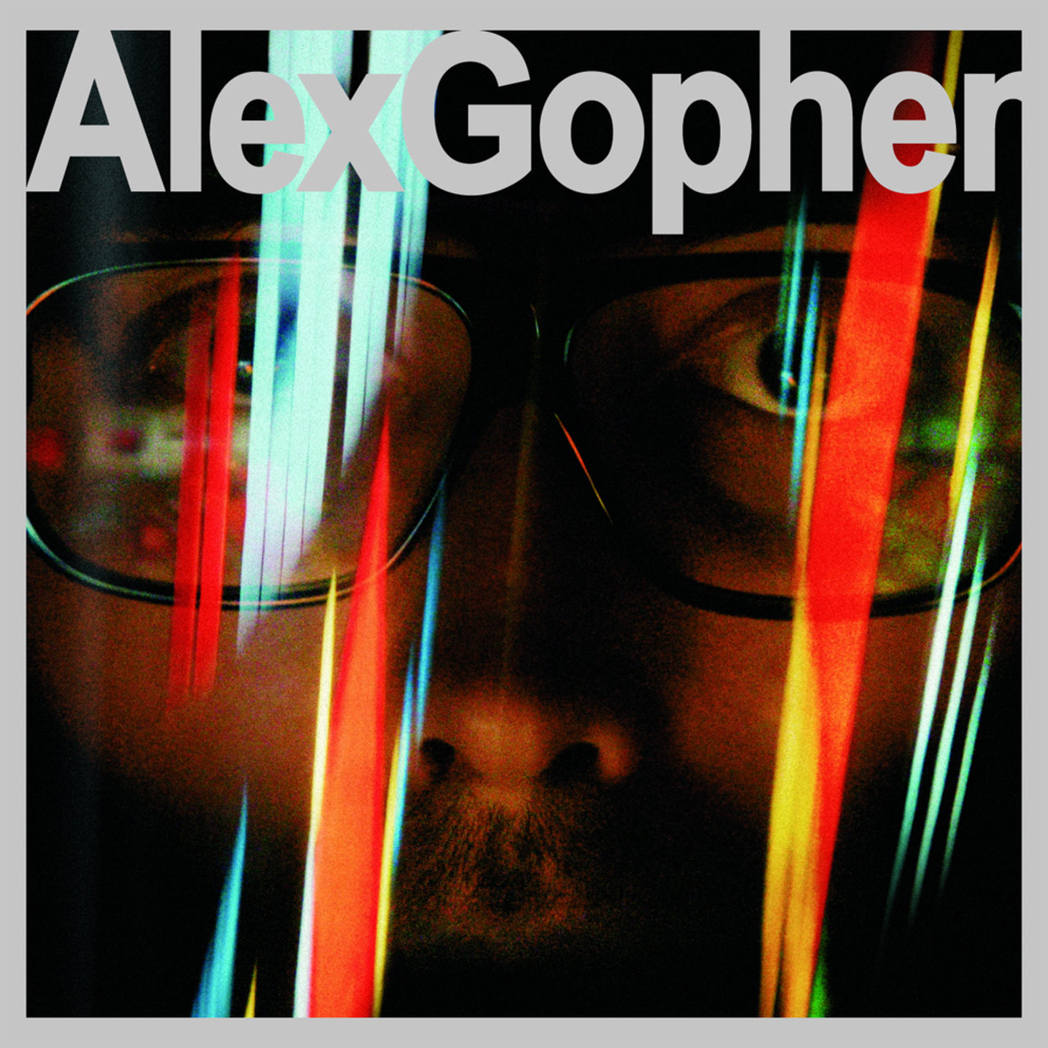

Une période creuse s’annonce enfin dans votre agenda, avant les festivals de l’été…
Clément Daquin : On va aller se poser le cul dans le sable à La Réunion pendant une petite dizaine de jours, parce qu’on a une date là-bas et qu’on a finalement loué une baraque de ouf pour pouvoir y rester. Personne n’avait particulièrement prévu de partir en vacances à ce moment-là, mais ça va faire du bien, un peu de repos forcé pour tout le monde… En fait, j’ai l’impression d’être dans une autre vie, d’être complètement hors du temps depuis deux ans. C’est tout le problème d’un projet, surtout lorsqu’il se développe aussi bien : on ne fait plus que ça… C’est fatiguant de réfléchir et d’être toujours présent à la fois sur toute la créa’ et un peu tous les autres spots… Si on était cinq à bosser, genre un groupe, ALB prendrait beaucoup moins de place dans ma vie, et j’aurais plus de temps pour faire autre chose. Malheureusement, je n’ai même plus trop le temps de m’intéresser à autre chose en ce moment. Ça me manque. Beaucoup.

Et vous, Raphaël, comment conciliez-vous les tournées avec ALB et l’évolution de votre autre projet, About the Girl ?
Raphaël Jeanne : Ça se passe plutôt bien, parce que j’ai pas mal de matière déjà avancée. Comme je bosse essentiellement avec un ordinateur, si j’ai envie de prendre le temps d’y travailler, je peux. Donc, tout se juxtapose très bien. C’est con, mais tout participe aussi à une dynamique : taper sur scène, ça me déleste de pas mal de stress et, du coup, je suis plus performant quand je bosse ! Il n’y a pas d’inconvénient à travailler ce truc-là en même temps, sauf si nos tournées se chevauchent…
Clément Daquin : Heureusement, les emplois du temps ne se croisent pas totalement. Et pourtant, c’est un vrai casse-tête : toute l’équipe a d’autres projets, d’autres priorités…
Raphaël Jeanne : Et pour le moment, mon projet ne cherche pas à défendre son identité sur scène. En tous cas, ce n’est pas comme ça qu’on a envie de « sortir de l’anonymat ». Donc, dans ma tête, ce n’est pas : « Oh non ! Il faut que je trouve du temps pour qu’on puisse organiser une tournée dans plein de salles en France ! »
Clément, que pensez-vous d’About the Girl ?
Clément Daquin : C’est cool… Amandine [Denis, ndlr], c’est une super copine, je l’aime beaucoup. Elle me fait marrer (rires). Qu’elle ait choisi Raphaël pour travailler, ça ne m’étonne pas : c’est un garçon très efficace et très polyvalent. Du coup, c’est un projet complètement viable, avec des personnes qui ont envie de le faire avancer. Musicalement, je trouve ça hyper bien. J’aimerais juste qu’Amandine chante en français – je la fais tout le temps chier avec ça ! – parce que je suis persuadé qu’avec le créneau dans lequel elle est, en France en tous cas, il pourrait se passer un truc, y avoir une accroche directe. Ce serait quelque chose d’assez inédit, ici. Après, ça passe très bien en anglais aussi… Et je comprends bien leur volonté – la même que la mienne, d’ailleurs –, de viser un marché international.
Come Out !… se vend-il à l’étranger ?
Clément Daquin : Non. Et c’est mon seul regret avec Sony : autant ils ont extrêmement bien bossé sur l’album en France, autant ils n’ont pas du tout bossé l’étranger. C’est encore possible, mais ils n’ont pas grand monde pour ça. Je le savais en signant : développer à l’international, ce n’est ni leur point fort ni leur priorité. Généralement, ça demande beaucoup d’argent et de temps… L’international, c’est compliqué. C’est un autre monde : il faut trouver un label sur place, faire d’autres pressages, et les sorties se gèrent séparément – bref, on recommence le travail de zéro. Et puis il y a aussi des pays qui veulent des exclu’, à savoir soit une sortie en avant-première soit une version différente de l’album. Donc, voilà, c’est un peu mort pour le Japon, bien que Come Out !… soit sorti en import là-bas et que des Japonais l’aient acheté…


Vos textes sont pourtant en anglais…
Clément Daquin : Je n’ai pas une écriture particulièrement politisée ou engagée – c’est même quelque chose que j’ai tendance à ne pas apprécier, musicalement : après tout, je fais de l’entertainment… L’anglais transforme des formules qui seraient trop intimes ou qui délivreraient trop de moi en gimmicks, et du coup en sentiments plus généraux, qui s’appliquent à tout le monde. L’anglais me permet à la fois d’étendre le discours et d’instaurer une distance puisque c’est une langue qui véhicule des images plus que des situations précises. Le français amènerait une certaine intimité qui n’est pas là où je voudrais la situer – parce que tout le monde s’en fout de ma vie, en fait : ce n’est pas le propos.
Certaines de vos chansons ont pour sujet des membres de votre famille, et la plupart ont finalement des propos très intimes.
Clément Daquin : Ouais… En fait, je ne parle pas tout à fait de moi : j’écris mes paroles en commençant par quelque chose qui vient de moi, une part de vécu, et puis je dérive… Je pense qu’à peu près tout le monde fait pareil. Je parle effectivement de mes neveux, ou de ma fille, par exemple, il y a quelques indices qui peuvent laisser sous-entendre que je parle de mon enfant dans Oh Louise, mais ça pourrait être autre chose : une autre personne liée à ce genre de sentiment.
Le meilleur que l’on puisse souhaiter à ALB, aujourd’hui ?
Clément Daquin : D’écrire des chansons. De trouver une nouvelle maison et un nouvel endroit où je vais aller enregistrer mes chansons, un studio – mais la pièce, pas le matos. Parce que j’ai absolument tout le matériel pour jouer – j’ai plus de synthés qu’il n’en faut : c’est vraiment du « synth’ porn », à ce stade ! –, pour enregistrer, j’ai largement de quoi produire et réaliser moi-même le prochain album. Et une fois que j’y aurais installé tout mon merdier, quand tout sera branché, je pourrai enfin faire : « (soupir) Alors… "Tou-dou-dou" : ah, ça marche, là ! "Ti-dou-di-ba-boing" : ah, là, ça marche aussi ! Allez, c’est parti ! Nuit blanche ! »
COME OUT ! IT’S BEAUTIFUL, DE ALB (ARISTA / SONY MUSIC, 2014)
Mickaël Pagano, 2015
© PHOTOS : DR, CHEVALVERT, SYLVÈRE HIEULLE